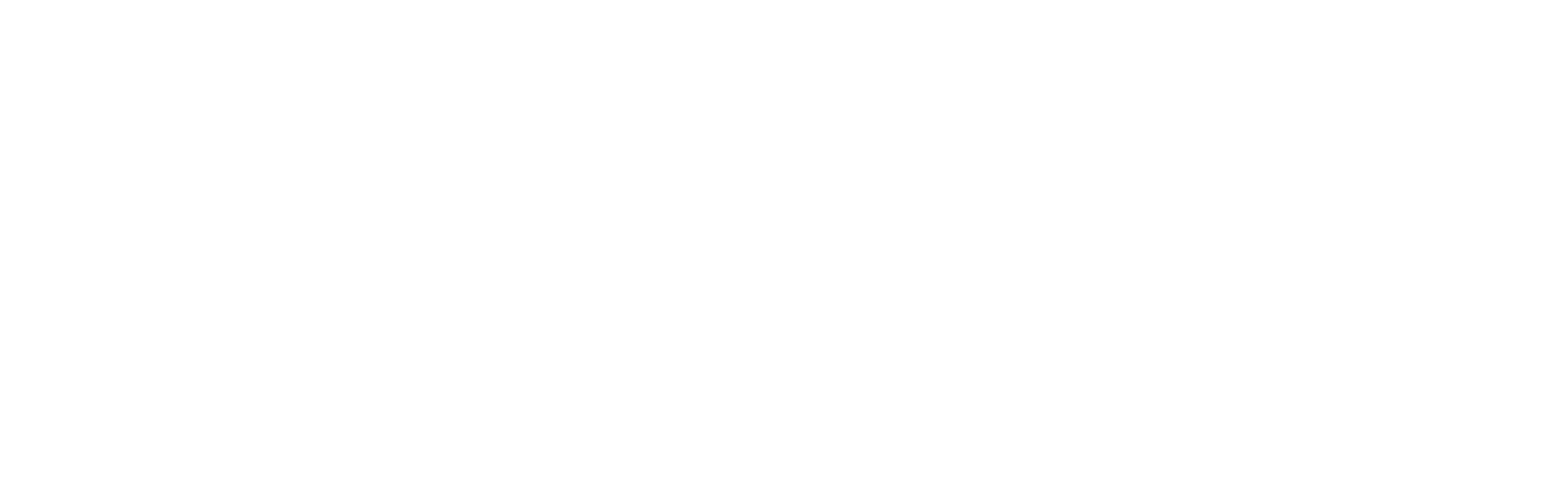Par Malina Khim, stagiaire en droit au GAIHST
Cela va sans dire, le milieu du travail est un environnement propice au stress en tout genre, qu’il soit question des attentes de rendement ou des relations interpersonnelles entre les personnes salariées et l’employeur·euse.
Si plusieurs problématiques peuvent naître de l’entrecroisement de ces différents facteurs, toutes ne valent pas nécessairement un abus du droit de gestion ni une plainte en harcèlement psychologique.
Essayons une fois de plus de baliser ce droit afin de comprendre la différence entre l’exercice normal et légitime du droit de gestion et les situations qui peuvent dériver vers l’abus.
Qu’est-ce que le droit de gestion?
Le droit de gestion est le pendant du lien de subordination qui caractérise la relation entre l’employeur·euse et ses employé·es. Il permet à l’employeur·euse de contrôler et d’encadrer les salarié·es afin d’assurer la bonne prestation du travail, dans la visée d’atteindre les objectifs économiques de son entreprise. Ainsi, votre patron·ne ou les superviseur·euses investi·es du même droit ont les pouvoirs d’attribuer des tâches aux travailleur·euses, d’évaluer leur rendement, de faire respecter les règles et procédures du milieu de travail, et d’appliquer des mesures disciplinaires pour les redresser si les circonstances l’exigent — pour n’en nommer que quelques-uns. Ces pouvoirs sont aussi assortis de responsabilités, telles que l’obligation de prévention de harcèlement psychologique, sexuel et discriminatoire, et le devoir d’assurer la santé et la sécurité sur les lieux de travail.
Notez que cette définition du droit de gestion est inspirée des informations fournies par la CNESST et ne représente pas un avis légal sur le sujet.
Les mesures disciplinaires
Dans l’exercice de son droit de gérance, l’employeur·euse peut imposer des mesures disciplinaires à son employé·e à qui des manquements sont reprochés, qu’ils soient liés à sa prestation ou bien à sa conduite. L’employeur·euse ne doit pas perdre de vue le but premier des mesures disciplinaires, soit le réalignement de l’employé·e. À cette fin, l’employeur·euse doit normalement appliquer le principe de la gradation des sanctions: sanctionner de façon progressive et proportionnelle à la gravité de la faute.
Selon la situation, pas de congédiement à la première gaffe! De cette manière, l’employé·e fautif·ve est avisé·e de ses manquements et dispose du temps et des moyens nécessaires pour pouvoir y remédier. La compréhension des conséquences associées aux manquements permet à la personne de prendre responsabilité et de ne pas reproduire les mêmes erreurs.
Qu’est-ce que le bon exercice du droit de gestion?
Le droit de gestion accorde une large marge de manœuvre à l’employeur·euse, mais il n’est pas sans limites. Le droit de gestion bien exercé est celui qui l’est de façon raisonnable, plutôt qu’arbitraire. Le critère de raisonnabilité fait référence à la conduite d’un·e employeur·euse compétent·e, prudent·e et diligent·e, posant des actions en lien légitime avec le fonctionnement de l’entreprise, et qui sont justes et équitables compte tenu des circonstances. Tant et aussi longtemps qu’il·elle demeure à l’intérieur de ce cadre, l’employeur·euse est dans son droit de vous rappeler à l’ordre ou d’émettre des critiques négatives sur votre travail. L’employeur·euse dont la conduite déborde ce cadre se retrouve en abus de droit, qui peut potentiellement dégénérer en harcèlement psychologique, si les critères sont remplis!
Simple abus du droit de gestion ou harcèlement psychologique?
Tout harcèlement psychologique au travail causé ou toléré par l’employeur·euse peut constituer un abus… mais l’inverse n’est pas vrai pour autant. Selon l’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail, le harcèlement psychologique se définit en cinq critères cumulatifs : la conduite vexatoire, qui est répétée ou grave, hostile ou non désirée, portant atteinte à la dignité ou l’intégrité, et entraînant un milieu de travail néfaste. La déconsidération constante, les attaques personnelles, l’isolation intentionnelle ou encore l’attribution de tâches inutiles peuvent toutes constituer des manifestations de harcèlement— l’important, c’est que ces actes s’inscrivent dans un continuum qui répond aux cinq conditions établies. Si c’est le cas, on pourrait alors parler d’abus du droit de gestion sous forme de harcèlement psychologique.
La loi est limpide à ce sujet : toute forme de harcèlement psychologique en milieu de travail est intolérable. L’employeur·euse doit ainsi prendre les moyens raisonnables pour prévenir et mettre fin au harcèlement, par l’adoption de politiques internes. Cependant, il n’est pas toujours évident de mettre la théorie en pratique. La question des mesures de prévention a d’ailleurs suscité un grand engouement parmi les auditeur·ices présent·es lors de nos deux séances, qui ont soulevé plusieurs doutes et interrogations quant à l’efficacité de mesures en place. Les cafés-rencontres du GAIHST visent justement à offrir un forum idéal pour non seulement outiller, mais également pour permettre de partager autant des expériences, des conseils et des inquiétudes.